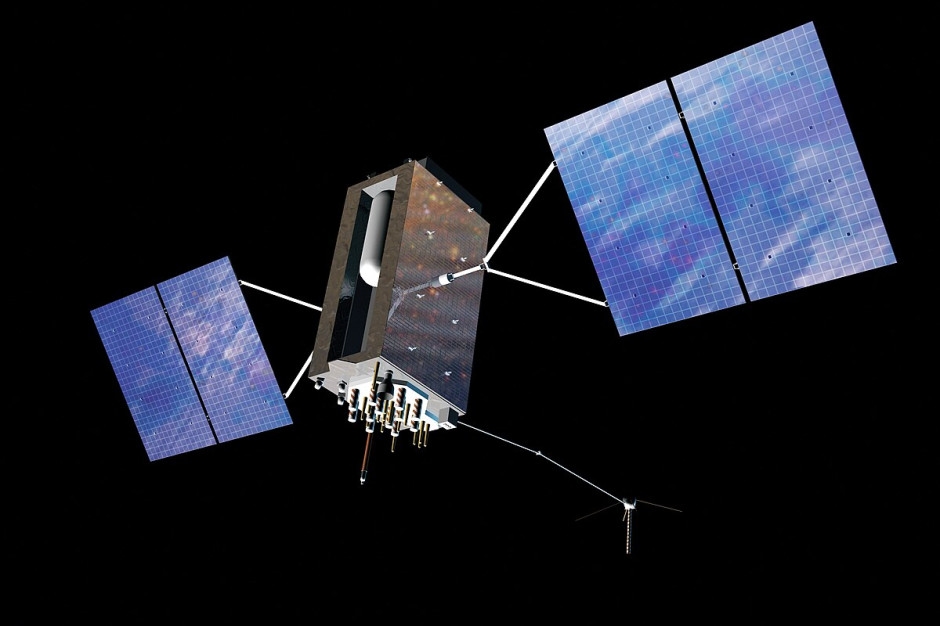Pourquoi dormons-nous ? Pour réparer les dommages causés par la respiration, selon les chercheurs.

Les cellules nerveuses sont très énergivores. Mais lorsque leur métabolisme énergétique s'emballe, il endommage les centrales énergétiques internes. Elles ont besoin de périodes de repos régulières pour récupérer.

Les dauphins alternent le sommeil en sollicitant indifféremment l'hémisphère droit ou gauche de leur cerveau. Les girafes n'ont besoin que de deux heures de sommeil par jour, tandis que les chauves-souris en requièrent près de vingt. La forme et la durée du sommeil présentent une grande diversité, mais une constante demeure : le règne animal dépend de ces périodes de repos. Nous, les humains, ne pouvons pas non plus fonctionner sans sommeil ; en moyenne, nous passons un tiers de notre vie à dormir.
NZZ.ch nécessite JavaScript pour fonctionner correctement. Votre navigateur ou votre bloqueur de publicités en empêche actuellement l'exécution.
Veuillez ajuster les paramètres.
Mais ceux qui dorment se retrouvent dans un état de vulnérabilité et de désespoir, risquant par exemple d'être tués par des ennemis. De plus, ils renoncent à des activités essentielles comme la recherche de nourriture et d'un partenaire. D'un point de vue de biologie évolutive, le sommeil demeure donc une grande énigme : pourquoi les organismes animaux ne peuvent-ils se passer de ces pauses dangereuses et coûteuses ?
Après des décennies de recherches approfondies, une équipe dirigée par Gero Miesenböck à l'Université d'Oxford est sur le point de trouver une réponse. Ces neurophysiologistes ont étudié la drosophile afin d'examiner comment le besoin de sommeil évolue au cours de la journée. Dansplusieurs publications scientifiques , ils ont décrit comment l'organisme détermine le moment où il est temps de se recoucher.
Chaîne de raisonnement logiqueLe sommeil remplit de nombreuses fonctions. Il joue un rôle central dans l'apprentissage et la régulation du système immunitaire, comme l'ont démontré de nombreuses études. Cependant, Miesenböck et son équipe affirment que le sommeil sert avant tout un but encore plus fondamental : il garantit que les cellules ne subissent pas de dommages excessifs lors de leur respiration et qu'elles obtiennent ainsi l'énergie nécessaire à leur survie.
Ces dernières années, les chercheurs ont rassemblé divers éléments de preuve pour étayer leur thèse. Ils combinent désormais ces éléments avec leurs résultats, récemment publiés dans la revue « Nature », afin de constituer un raisonnement cohérent .
Cette série d'événements décrit ce qui se passe à l'intérieur de cellules nerveuses spécialisées. Lorsque ces cellules s'activent, elles plongent le reste de l'organisme dans un état de sommeil. Chez l'humain, des dizaines de milliers de cellules appartiennent au centre de contrôle du sommeil, tandis que chez la drosophile, il n'en compte qu'une trentaine. Les cellules de ce centre possèdent une sorte de capteur qui mesure la pression du sommeil, autrement dit, indique le degré de fatigue croissant.
Transformation en agent chimique extrêmement dangereuxComme l'ont démontré Miesenböck et son équipe il y a six ans, ce capteur réagit aux acides gras endommagés. Ces dommages peuvent être causés par la respiration cellulaire dans les mitochondries. Ces organites cellulaires spécialisés sont souvent qualifiés de centrales énergétiques de la cellule, car ils sont responsables de la production d'énergie.

Bsip / Groupe éditorial Universal Images
Dans les mitochondries, les aliments sont métabolisés. Au cours de cette réaction chimique, des électrons sont transférés à l'oxygène, libérant ainsi de l'énergie. Grâce à un système complexe appelé chaîne de transport d'électrons, les mitochondries captent l'énergie des électrons et la convertissent en une autre forme d'énergie chimique : l'adénosine triphosphate, ou ATP. Il s'agit du transporteur d'énergie universel que les cellules utilisent pour assurer leurs processus biochimiques.
Lorsque les électrons suivent leur chemin prédéterminé dans la chaîne de transport d'électrons, quatre d'entre eux atteignent simultanément l'oxygène. C'est ainsi que se forme l'eau, molécule inoffensive. Il arrive cependant qu'un électron s'échappe et se lie directement à l'oxygène.
C’est grave car si l’oxygène absorbe un seul électron, il se transforme en une substance chimique très dangereuse, appelée radical oxygène : pour acquérir davantage d’électrons, le radical oxygène détruit tout ce qu’il rencontre.
Souvent, des molécules lipidiques issues de la membrane mitochondriale sont nécessaires. Plus les mitochondries métabolisent intensément les aliments, plus elles produisent de radicaux libres oxygénés et plus les acides gras sont dégradés. Ces radicaux sont ensuite distribués dans toute la cellule et atteignent le canal ionique, où ils rencontrent le capteur et déclenchent finalement l'activation des cellules induisant le sommeil.
Comme un fusible dans un circuit électriqueMiesenböck compare les cellules induisant le sommeil à une sorte de fusible dans un circuit électrique. « Si le courant est trop important, le fusible saute en premier. Cela protège les autres composants. »
Les cellules du centre de contrôle du sommeil n'interrompent pas directement un circuit électrique, mais elles initient une phase de repos durant laquelle le système surchauffé peut se refroidir et se régénérer. Pendant le sommeil, les mitochondries ont le temps de réparer les dommages accumulés durant la journée.
Les mitochondries produisent l'énergie dans toutes les cellules du corps. Pourquoi les cellules impliquées dans le sommeil sont-elles les plus sensibles ? Selon Miesenböck et son équipe, il y a deux raisons. Premièrement, les cellules nerveuses nécessitent une quantité d'énergie exceptionnellement élevée par rapport aux autres cellules du corps. « Le cerveau représente environ deux pour cent de notre poids corporel, mais consomme environ vingt pour cent de l'oxygène que nous respirons », explique Miesenböck. C'est pourquoi les cellules nerveuses doivent lutter plus efficacement contre les radicaux libres que les autres cellules.
Deuxièmement, « les cellules responsables du sommeil fonctionnent de manière contracyclique », explique Miesenböck. Elles sont moins actives lorsque nous sommes éveillés et que nous mangeons. Or, précisément lorsque les mitochondries disposent de suffisamment de carburant, les cellules ont besoin de peu d'énergie. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande rend la respiration cellulaire mitochondriale plus sujette aux erreurs et entraîne la formation d'un plus grand nombre de radicaux libres oxygénés.
Que se passe-t-il en cas de manque de sommeil ?Dans leur dernière étude, l'équipe de recherche a examiné ce qui se passe dans les cellules responsables du sommeil lorsque des mouches sont privées de sommeil pendant une nuit. « Nous avons fait semblant d'être stupides afin d'étudier, de la manière la plus ouverte et impartiale possible, quels processus biologiques sont déclenchés ou inhibés par la privation de sommeil », explique Miesenböck.
Constater que les résultats de cette analyse correspondaient précisément aux résultats antérieurs concernant le canal ionique fut pour lui une grande satisfaction. Tous les gènes dont l'activité est accrue lors du manque de sommeil jouent un rôle dans la production d'énergie. Au microscope, les chercheurs ont également observé qu'après une nuit blanche, les cellules induisant le sommeil contenaient davantage de mitochondries, mais que celles-ci étaient nettement plus petites.
Il semblerait que le manque de sommeil entraîne une augmentation de la division des mitochondries, une sorte de mécanisme de protection. « Nous pensons que ces divisions permettent de séparer les régions endommagées des régions encore fonctionnelles, afin que les régions endommagées puissent ensuite être éliminées par le système d'élimination des déchets cellulaires », explique Miesenböck.
Dans d'autres expériences, les chercheurs ont démontré que le lien entre le manque de sommeil et la petite taille des mitochondries fonctionne également dans l'autre sens : lorsqu'ils ont utilisé le génie génétique pour accélérer la division des mitochondries chez les mouches, les cellules impliquées dans l'induction du sommeil s'activaient moins fréquemment et les mouches dormaient moins longtemps. Inversement, des mitochondries qui fusionnent davantage entre elles, formant ainsi des compartiments moins nombreux mais plus grands dans les cellules, entraînent des durées de sommeil plus longues.
Besoins fondamentaux de récupération du métabolisme énergétiqueD'après leurs résultats, les chercheurs concluent que le sommeil est une adaptation à la respiration oxygénée : ce comportement a évolué pour répondre à un besoin fondamental de récupération du métabolisme énergétique. « La cause du sommeil est un simple problème biochimique », explique Miesenböck.
D'après lui, ces résultats expliquent aussi pourquoi les personnes atteintes de maladies mitochondriales se sentent constamment épuisées. « Elles ne souffrent pas de faiblesse musculaire, leurs mitochondries produisent donc suffisamment d'énergie », explique Miesenböck. « Mais à cause de la maladie, davantage d'électrons s'échappent. Cela entraîne un besoin accru de sommeil. »
Il compare les électrons qui s'échappent à des grains de sable dans un sablier : de nouveaux électrons sont constamment ajoutés, et leur nombre indique quand il est temps de rétablir l'équilibre – et donc de s'endormir.
Miesenböck compte-t-il donc des électrons plutôt que des moutons dans sa tête lorsqu'il n'arrive pas à s'endormir ? « Non », répond-il. « Heureusement, je dors généralement bien. Mais si, une nuit, je suis assailli par des soucis, j'allume la lampe de chevet – au grand dam de ma femme. Et je lis jusqu'à ce que la fatigue me gagne et que je puisse me rendormir. »
nzz.ch